Plus un jour ne passe sans que l’on voit se succéder les propositions pour une réponse économique à la crise sanitaire qui prenne en compte les impératifs socio-écologiques. Prenons l’exemple de cette récente tribune co-signée par Madonna comme Hulot, de Niro comme Naomi Klein. Que revendique ce club inattendu ? Que les investissements consentis par les États dans le cadre de la relance post-COVID prennent en compte les risques futurs de la toute aussi urgente et incertaine crise écologique.
Apparemment caractérisée par un retour de l’État – sous-entendu que ce dernier se serait retiré au profit d’acteurs privés – la crise pandémique nous révèle plutôt son nouveau rôle : celui d’assureur en dernier recours. Bien loin de s’en contenter, certains comme l’économiste Michel Aglietta propose des solutions de type « Green New Deal Global » d’inspiration keynésienne. L’appel d’un grand nombre de parlementaires européens lancé par le député Pascal Canfin pour une relance verte souhaite également que l’État ne soit plus simplement présent pour couvrir les risques, éponger les pertes et permettre un retour à la situation ex ante, mais qu’il devienne l’acteur central d’un « nouveau modèle de prospérité ».
Mais quels sont les hypothèses et outils qui ancrent de telles propositions, et permettent d’arbitrer et donc de comparer les coûts et bénéfices à la fois économiques, sanitaires et écologiques d’une politique publique ?
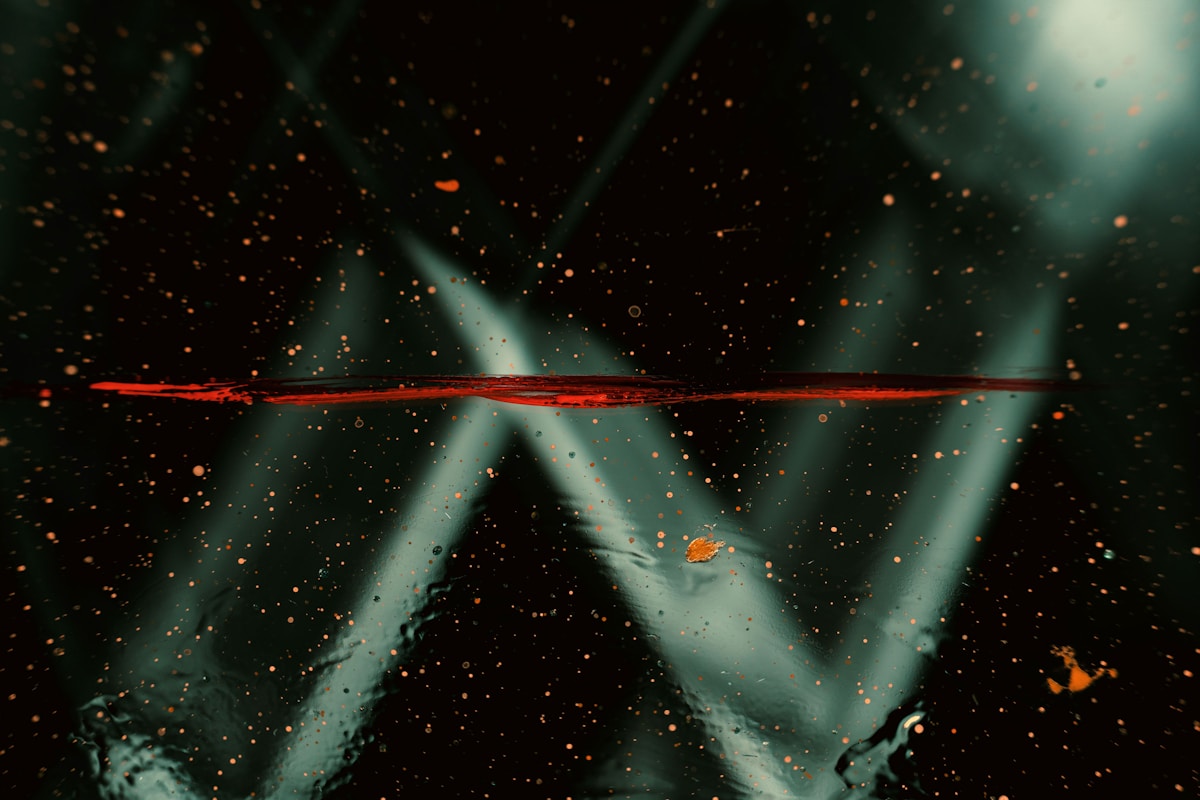
L’espoir du « triple-win »
L’apparition du COVID-19 découlerait de l’emprise de l’Homme – et de ses activités économiques – sur les milieux naturels. Il existerait ainsi des liens (certes complexes et diffus) entre disparition des écosystèmes et pandémies, eux-mêmes liés aux dérives du capitalisme mondialisé. Cette position a été récemment relayée en Suisse par une tribune (encore une !) de 120 scientifiques, ou en France par l’anthropologue Philippe Descola qui a identifié cette pandémie comme le révélateur de la dégradation continue des milieux de vie par l’Homme. Il souligne ici l’impasse dans laquelle nous plonge un « système de production mondialisé fondé sur la production au moindre coût et à la non-prise en considération du coût écologique ».
Une relance économique verte permettrait alors non pas de faire « coup-double », mais bien « coup-triple » : relancer la machine économique, atténuer les effets de la crise écologique, mais également éviter de nouvelles pandémies futures. Rarement les enjeux ont été aussi multiples, et leurs relations incertaines. Face à l’immensité de la tâche, la première réaction est de désigner le responsable : notre système capitaliste mondialisé aux effets destructeurs. Toutes et tous soulignent donc l’opportunité de cette crise pour changer de direction : «Please, let’s not go back to normal ».

Back to normal ?
Pourtant, au-delà des discours, tribunes et autres appels collectifs, les outils économiques qui sous-tendent de telles propositions n’ont eux, rien de plus normaux.
Pour rendre compte de ces trois objectifs – ou les relations entre ces différents enjeux – il faut les rendre comparables avec une comptabilité unique. Et la discipline économique ne manque pas d’idées pour transformer tout fait social ou écologique en une donnée monétaire – unité de compte ou convention idéale pour permettre de telles comparaisons dans le temps.
Ainsi, divers outils quantitatifs inspirés de l’économie dite « du bien-être » (Welfare Economics, économie tout ce qui a de plus « standard »), visent à ramener aussi bien la nature (des unités de carbone en passant par la grande barrière de corail) que la vie à une variable économique. Tout doit être fait pour que les risques, sanitaires et écologiques soient intégrés (ou internalisés) aux modèles économiques.
Au-delà de la hiérarchie facilement perceptible entre ces trois paramètres (la nature et la pandémie sont « mises en économie », non pas l’inverse), ce raisonnement pose d’autres problèmes : celui des méthodes employées.
Un outil économique au cœur de cette conversion est le taux d’actualisation, permettant de rendre compte économiquement de risques futurs qui échapperaient en temps normal aux modèles économiques. Cet outil permet par exemple d’attribuer une valeur à une vie qui n’existe pas encore, ou de mettre en balance les coûts présents de la transition écologique (en termes d’investissements) avec les potentiels futurs bénéfices découlant de ces investissements.
On touche ici à la classique analyse coûts-bénéfices prônées depuis les années 1990 notamment par l’influente Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et ses nombreux rapports, aussi bien en matière de politique environnementale que sanitaire.

Décider aujourd’hui, bénéficier/subir demain
Depuis 2006 et le désormais célèbre Rapport Stern sur l’économie du changement climatique commandité par le gouvernement britannique, de nombreux chiffres ont alimenté les débats pour savoir quelle somme était nécessaire afin de faire face à la crise écologique.
La grande question étant celle du fardeau à laisser aux générations futures (la dette versus la crise écologique). Ce débat technique qui se cristallise justement autour du taux d’actualisation a notamment été « popularisé » par William Nordhaus, Prix Nobel d’Économie 2017, pour ses travaux économétriques sur les liens entre économie et changements climatiques. Le taux d’actualisation vise selon Nordhaus à répondre à la question suivante : “how much and how fast”.
Au niveau microéconomique, le taux d'actualisation pose une question simple : préférons-nous des avantages (généralement monétaires) aujourd'hui, ou une somme incertaine mais potentiellement supérieure dans le futur ?
Ramené à l’environnement, la question pourrait être la suivante : préférons-nous payer 150 euros aujourd’hui pour maintenir notre climat sous la cible d’augmentation des 1.5 degrés et ainsi éviter une dangereuse montée des eaux, ou 50 euros en pariant sur d’incertaines avancées technologiques permettant d’y faire face, au risque de devoir débourser alors bien plus ?
Si notre choix se dirige vers la première option (comme les économistes standards le suggèrent, puisque nous sommes des êtres rationnels cherchant à maximiser notre utilité, ayant ainsi une « préférence pour le présent »), le taux d’actualisation sera positif : nous accordons ainsi une valeur plus grande au présent qu’au futur.
Alors que Nordhaus a souvent utilisé un taux de 4,3 % dans ses différentes modélisations (considérant qu’il était économiquement préférable d’attendre avant d’investir trop de ressources), Stern a choisi un taux (provocateur pour l’époque) de 1% dans son rapport de 2006, ce qui signifiait qu’également 1% du PIB devait chaque année être dédié à la transition écologique – soutenant au contraire de Nordhaus une action relativement rapide.
Puis il a rapidement changé d’avis pour aller jusqu’à proposer 2% d’investissement du PIB en faveur de la transition écologique. Et le Green New Deal version américaine est justement chiffré aux environs de 2% du PIB, quand le récent Green Deal de l’UE vise à investir 1.5% du PIB d’ici à 2030.

Le marteau, le clou… et le piège de l’économie verte
Ramener ces considérations sanitaires ou écologique à une variable économique permet d’affronter les acteurs les plus récalcitrants sur leur propre terrain : démontrer chiffres à l’appui que loin d’être un coût, la lutte contre la crise écologique peut être une opportunité. Et pour cause les bénéfices (en termes sanitaires, d’emploi ou de création de nouveaux marchés) seront à long terme supérieurs aux coûts de l’inaction.
Il est en effet nécessaire d’avoir de solides arguments face aux nombreuses résistances qui ne souhaitent pas seulement maintenir le business as usual, mais faire un pas en arrière, comme c’est le cas des États-Unis, de la Pologne ou la République Tchèque qui rejettent l’utilisation du Green Deal comme boussole de la relance post-Covid. Et ces gouvernements ne manquent pas de soutiens, puisque de nombreux lobbys industriels se saisissent également de la situation sanitaire pour s’attaquer aux normes environnementales en vigueur.
Dans ce contexte, les méthodes de calculs introduites ci-dessus peuvent très bien soutenir leur raisonnement : relancer la machine économique aujourd’hui quoi qu’il en coûte écologiquement, pour se préoccuper demain des enjeux environnementaux – une fois l’économie remise sur pied. Rationnellement infaillible avec le « bon » taux d’actualisation !
Les battre sur leur propre terrain semble alors être une bien vaine initiative. En matière de politique sanitaire, la polémique suite aux mesures prises par l’ancienne ministre de la santé Roselyne Bachelot suite à la grippe H1N1 reflètent une réalité similaire : l’arbitrage entre des économies réalisées à court terme qui ignorent les coûts d'une crise à long-terme.
Ce type d’analyse coûts-bénéfices permet finalement à de multiples arguments de coexister, sans que l’un ne semble plus convaincant qu’un autre : le piège de l’économie verte.
Le temps est donc venu de s’écarter de ce type de raisonnement – puisque comme l’expression bien connue d’Araham Maslow le souligne : « si le seul outil que vous avez est un marteau, vous tendez à voir tout problème comme un clou ».
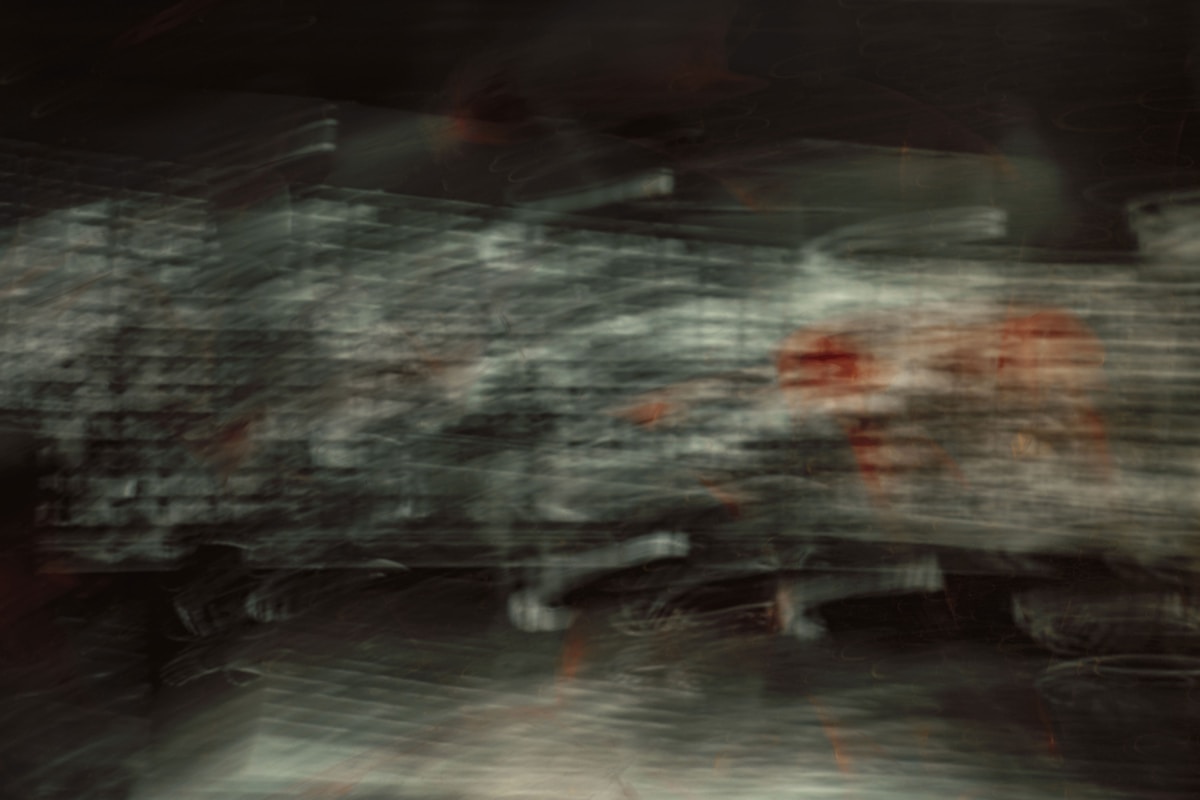
Dépasser la quantification, l’incertitude et l’action
L’épidémie fait ressurgir une notion oubliée par l’économie et sa propension à tout intégrer à divers modèles quantitatifs : celle de l’incertitude.
En plus du célèbre Black Swan de Nassim Taleb, caractérisant des événement rares, imprévisibles, et dont l’impact est extrême – concept largement relayé dans ce contexte de pandémie – les économistes ont délaissé les contributions de leurs glorieux aînés.
Keynes tout d’abord, et son concept d’incertitude radicale. Mais un autre économiste avait il y a bientôt 100 ans encore mieux conceptualisé de telles situations : Frank Knight, et son concept de true uncertainty, à savoir une forme d’incertitude qui échappe à toute tentative de quantification. Dans de tels cas, il nous faut accepter que tout ne peut pas être compté et comparé, ce qui nous force à nous écarter des analyses type coûts-bénéfices.
« C'est compliqué de faire des prévisions économiques en ce moment », estimait récemment une source de la Commission européenne en mentionnant les retards que prendrait le Green Deal. Dans un même temps, des économistes ont récemment clamé haut et fort « Act fast and do whatever it takes».
Formule également utilisée par Emmanuel Macron, indiquant que le gouvernement soutiendra les entreprises et les salariés « quoi qu'il en coûte ». En d’autres termes : « à bas les certitudes, c’est le temps de l’action ! ». Une formule comparable serait-elle envisageable pour la crise écologique ? Du « how much and how fast »de Nordhaus, nous passerions alors à un « as much and as fast ». Car si la crise sanitaire offre un enseignement, c’est bien notre capacité d’action en situation d’incertitude.
